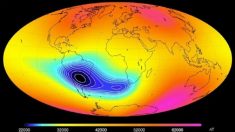A deux roues, des jeunes sillonnent Le Caire pour livrer plus d’un million de commandes par jour, un petit boulot qui attire de plus en plus mais les laisse sans protection sociale, ni même physique dans la mégalopole au trafic chaotique.
« Ils vous sucent jusqu’à la moelle mais on n’a pas le choix », se lamente Mohammed Chérif, un ingénieur de 37 ans, coursier à vélo depuis trois mois faute d’emploi dans son domaine.
En Egypte, face à la crise économique, la jeunesse diplômée mais chômeuse grossit les rangs de l’économie numérique.
L’inflation caracole à 12,1%, la livre égyptienne a chuté de 18% et la guerre en Ukraine fait flamber les prix.

A tel point que, récemment, une poignée des 12.000 livreurs de Talabat, la plateforme de livraison de repas qui emploie M. Chérif, ont fait grève.
Ils réclamaient un meilleur salaire, étranglés par des commissions variant de 45 à 90 centimes d’euros, et non réévaluées depuis 2020, selon l’un d’eux.
« On peut travailler neuf à dix heures par jour », affirme M. Chérif à l’AFP, et n’empocher « que 30 à 40 livres » (1,50 à 2 euros) une fois déduits l’essence et les autres frais, soit de quoi acheter trois à quatre kilos de pain.
Sans contrat ni assurance ou sécurité sociale
En Egypte, où 60% des 103 millions d’habitants ont moins de 30 ans et 14,5% des jeunes diplômés sont sans emploi, les plateformes font travailler entre 100.000 et 200.000 personnes. Rien qu’Uber en compte 90.000.
Autant de travailleurs indépendants sans contrat ni assurance ou sécurité sociale.
Selon le rapport Fairwork de l’Université d’Oxford et de l’Université américaine du Caire, aucune des sept plus grandes plateformes en Egypte ne garantit des conditions de travail dignes.
Notées sur 10, Uber et Talabat obtiennent un point. Swvl, start-up de transport en commun cotée au Nasdaq à plus d’un milliard d’euros, atteint 3/10. La meilleure, FilKhedma, plafonne à 5/10.
Deux tiers des Egyptiens vivent sous le seuil de pauvreté
Le PDG de cette plateforme de services à domicile, Omar Ramadan, reconnaît qu’« on parle très rarement de rémunération ou de savoir si on profite de la vulnérabilité des gens ».
Vulnérables, deux tiers des Egyptiens le sont: soit ils vivent sous le seuil de pauvreté soit ils s’en approchent dangereusement, selon la Banque mondiale.
En moyenne, un foyer égyptien vit chaque mois avec 6.000 livres (300 euros).

Talabat assure que ses coursiers gagnent entre 4.000 et 6.000 livres par mois et jusqu’à 10.000 « s’ils travaillent huit heures ou plus par jour ».
Faux, répondent les livreurs: ces chiffres ne s’appliquent pas à ceux à vélo ou à pied qui gagnent deux fois moins que ceux à moto.
Important roulement du personnel
Et surtout, ils ne prennent pas en compte le carburant, l’achat du deux-roues et sa maintenance, à la charge des livreurs qui ont récemment encaissé une nouvelle hausse de 3% du prix de l’essence.
Ces frais et le maigre salaire expliquent sûrement l’important roulement du personnel.
Omar Ramadan, PDG de FilKhedma, veut garder ses agents d’entretien car, dit-il, il ne peut pas envoyer des heures durant chez ses clients des gens qu’il connaît à peine.
« La satisfaction des employés n’est pas forcément aussi importante » pour d’autres entreprises, avance-t-il, « si elles ne demandent que peu ou pas de qualification et disposent d’une manne importante de travailleurs ».
Les coursiers mettent aussi leur vie en danger au Caire, ville tentaculaire de 20 millions d’habitants où le code de la route est peu respecté.
Se « débarrasser du sale boulot »
Asmaa Khalil, cadre chez Talabat, assure qu’ils bénéficient d’une assurance-vie et d’une couverture complète en cas d’accident, mais ajoute que c’est aux sous-traitants les employant de les fournir.
Un moyen, dit M. Chérif, de se « débarrasser du sale boulot ».
Seuls 13,6 millions d’Egyptiens bénéficient de la sécurité sociale dans un pays où, selon l’Organisation internationale du travail, 63% des employés travaillent dans l’économie informelle échappant totalement à l’Etat.
« Les plateformes sont dans une zone grise: on ne sait pas ce qu’on est censés faire en terme de droit du travail, d’impôts ou de sécurité sociale », explique M. Ramadan.
« On n’est obligés à rien », abonde Mme Khalil et tout ce que Talabat fait pour ses coursiers relève de sa « bonne volonté ».
Pour Waël Tawfiq, militant pour les droits des travailleurs, le meilleur recours serait de monter un syndicat.
Mais, répond M. Chérif, « si les ouvriers sont dans la même usine, nous, les coursiers, on ne se croise que par hasard ».
***
Chers lecteurs,
Abonnez-vous à nos newsletters pour recevoir notre sélection d’articles sur l’actualité.
https://www.epochtimes.fr/newsletter
Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?
Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.