Laurie Rimon s’est éprise de la ferme collective israélienne de Kfar Blum après y avoir passé une année de lycée en 1969‑70. Elle a émigré des États‑Unis vers Israël dès qu’elle a obtenu son diplôme d’études secondaires en 1971. Elle a maintenant la double nationalité.
Dans sa maison à Kfar Blum, Laurie Rimon explique pour Epoch Times l’énorme changement qui s’est opéré dans sa façon de voir les fermes collectives bénévoles de l’État juif, appelées « kibboutzim » (kibboutz au singulier).
Kfar Blum est un kibboutz situé à l’extrême nord d’Israël, près des frontières libanaise et syrienne.
À 40 ans, elle devait encore demander de l’argent à sa mère en Amérique pour acheter des billets d’avion afin de lui rendre visite dans l’ouest de l’État de New York, où elle a grandi.
Ceci tenait au fait que son kibboutz s’octroyait l’intégralité des salaires de ses membres quand bien mêmes ceux‑ci avaient un emploi indépendant. Croulant sous les dettes, le kibboutz n’avait pas d’autre choix.
Ce fut une des difficiles leçon du kibboutz.

Les premiers kibboutzniks souscrivaient souvent à des notions marxistes comme « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ».
Les générations suivantes, pas vraiment.
Il y en a environ 270 kibboutzim aujourd’hui en Israël. Ils sont globalement devenus plus capitalistes au fil du temps.
Le nom du kibboutz de Kfar Blum est un hommage au Premier ministre socialiste français Léon Blum. Il occupa ce poste à trois reprises dans les années 1930 et 1940. Les membres de Kfar Blum et d’autres kibboutzim ont découvert à leurs dépens que le socialisme ne fonctionne pas.
Laurie Rimon, aujourd’hui âgée de 68 ans, a commencé à travailler hors du kibboutz en 1988, pour une entreprise de technologie de l’éducation. Le kibboutz récupérait la totalité de son salaire. Il y avait de l’argent à son nom sur un compte. Mais Israël souffrait d’une terrible inflation. Et Kfar Blum, comme la plupart des autres kibboutzim, était endetté. Elle n’avait pas le droit de puiser dans son compte épargne, pas même pour réserver un vol.
« Tous les kibboutzniks étaient alors dans une situation financière terrible », se souvient‑elle.

Les kibboutzim symbolisaient la force d’un pays naissant tourné vers l’avenir. La plupart des Israéliens voulaient transcender un passé terrible.
De nombreux membres avaient risqué leur vie ou subi des voyages harassants pour arriver jusqu’en Israël. Ils étaient enthousiastes à l’idée de construire une nouvelle vie et une nouvelle nation, à l’idée de « faire fleurir le désert », comme on disait.
Ils se sont adaptés, sont devenus des travailleurs robustes résistants au soleil. Ils se sont défaits de tous les stéréotypes. Ce n’étaient plus les juifs appauvris et intimidés d’Europe de l’Est, pieux orthodoxes attendant patiemment le Messie, hommes d’affaires bourgeois ou fonctionnaires proprets.
Les kibboutzim ont produit les premiers soldats et généraux d’Israël. Avant et après l’indépendance, les kibboutzniks ont toujours surveillé les raids frontaliers et les tensions avec les Arabes. Ce fut par nécessité car les kibboutzim ont toujours été très isolés.

Les kibboutzniks appréciaient la vie communautaire. Les enfants étaient séparés de leurs parents et vivaient dans des foyers collectifs pour enfants. Cela permettait aux adultes de participer pleinement à la vie du kibboutz. Ils prenaient trois repas par jour dans le réfectoire et recevaient des produits alimentaires à emporter chez eux.
Laurie Rimon recevait des œufs, de l’huile, de la farine et des fruits. Cependant, il n’y avait généralement qu’un seul fruit selon la saison, en d’énormes quantités. « On ne pouvait pas faire une salade de fruits. »
« Quand ils ont changé le système, c’était étrange de devoir payer pour tout ça. ‘Quoi ? Je dois payer pour de la farine ?!’ Mais ensuite, on s’habitue à pouvoir acheter ce que l’on veut. Maintenant, je peux faire le gâteau que je veux. »
Les kibboutzniks fondateurs étaient socialistes. Les sionistes de droite préféraient les entreprises agricoles individuelles appelées « moshavim », où les fermiers coopéraient simplement les uns avec les autres.
Mais tous les kibboutzim ne se sont pas transformés, explique Avner Rimon, le mari de Laurie.

Avner Rimon mentionne deux kibboutzim restés socialistes. Ces deux kibboutzim particuliers peuvent se le permettre, car ils sont prospères, explique‑t‑il. « Ils vivent toujours selon les idéaux originaux des kibboutzim. On peut trouver des explications idéalistes, mais les vraies raisons, ce sont les finances. »
La plupart des autres kibboutzim se sont défaits du socialisme à contrecœur au fil des ans. Ils n’étaient pas viables. L’agriculture ne rapportait pas assez d’argent. Pour y remédier, les kibboutzim ont élargi leurs capacités, se sont lancés dans la fabrication, par exemple, mais le succès n’était pas toujours au rendez‑vous.
« Un kibboutz, c’est une petite entité », explique Avner Rimon. Ses parents étaient américains. Il est né à Haïfa, et la famille a déménagé à Kfar Blum lorsqu’il avait six mois. Il y a passé toute sa vie.
« La différence entre ceux qui réussissaient et ceux qui ne réussissaient pas, c’était ce qu’ils fabriquaient. Les chances de choisir un produit qui marchait étaient assez minces. »

« Il est devenu évident que nous ne pouvions pas nous en sortir avec la seule agriculture. Comme partout dans le monde, l’agriculture ne rapportait pas assez d’argent. »
« Énormément de kibboutzim sont devenus des usines de plastique. C’est une industrie low‑tech. Ça a marché pendant un certain temps. »
« Que le plastique soit une bonne affaire dépendait de sa qualité. Certains plastiques sont encore bons aujourd’hui. Mais on savait qu’on ne pouvait pas mettre tous les œufs dans le même panier. »

Kibboutzim et débuts d’Israël
Les kibboutzim ont joué un rôle central dans le développement d’Israël, avant et après son indépendance en 1948. Leur histoire est exposée dans une monographie publiée en 2005 écrite par Dubi Benari, habitant de Kfar Blum.
Dubi Benari écrit que les premiers colons juifs, à partir des années 1880, avaient tendance à former des moshavim, des fermes privées pour lesquelles tout le monde coopérait en matière de production et de commercialisation. Bien que semblables, les moshavim ont toujours été des « fermes coopératives », tandis que les kibboutzim des « fermes collectives ». La montée du mouvement socialiste au début du XXe siècle a cependant amené des colons qui préféraient un modèle collectiviste.
D’une certaine manière, ce modèle était plus adapté à l’époque.
Dans ce coin perdu au fin fond de l’Empire ottoman, les fermes privées devaient faire des profits pour survivre. Les kibboutzim ne recherchaient pas le profit. Ceci explique également pourquoi un si grand nombre ont fini par être très endettés.
Au début, cependant, ils étaient fonctionnels alors que les moshavim se débattaient. Le dédain des kibboutzniks pour le confort bourgeois était un atout, car un tel confort était pratiquement inexistant.

Les kibboutzim étaient nécessaires à l’ensemble de la colonie juive en Palestine. Ils fournissaient de la nourriture. Ils marquaient qu’un tel territoire était juif et le défendaient.
Ils pouvaient accueillir des entraînements militaires, loin de la surveillance britannique. Ils disposaient de nombreux endroits pour dissimuler des armes. C’est là que s’entraînait la Haganah, l’armée juive clandestine. Il était facile de camoufler ce type d’activités.
Le Palmach, la force de combat d’élite qui formera plus tard le noyau de la Force de défense israélienne (FDI), s’allie très tôt aux kibboutzim.
Les kibboutzniks après l’indépendance ne représentent qu’un faible pourcentage de la population. Ils donneront pourtant un nombre disproportionné de chefs militaires israéliens, généraux, parachutistes, commandos, etc.
Dans bien des pays, les garçons élevés à la campagne ont une forte présence dans l’armée. Ils sont capables de construire, réparer, vivre en plein air, utiliser des armes à feu, etc. Ils ne sont pas amollis par la facilité de la vie en ville.
Les enfants nés dans les kibboutzim deviennent ce type d’hommes, et leur éthique collective constitue un atout de plus dans l’armée.

En 1947, la partition de la Palestine par les Nations unies en deux États, juif et arabe, laisse aux juifs des territoires morcelés. À peine connectés, ces bouts de territoires sont difficiles à défendre.
Les Arabes n’acceptent pas la partition et envahissent le pays dès la proclamation de l’indépendance le 14 mai 1948.
Les dirigeants israéliens rejettent alors que la carte de partage et décident que les frontières seront celles qu’ils pourront saisir ou défendre.
Après la trêve de juin 1949, de nouveaux kibboutzim voient le jour sur les terres qu’Israël vient de remporter par la force. Il est question de mettre à profit la campagne, combler les lacunes entre les zones juives, relier Jérusalem aux zones à majorité juive le long de la côte méditerranéenne.

Les kibboutzim sont la première ligne de défense contre les fedayin, les combattants arabes qui s’infiltrent la nuit. Les Forces de défense israéliennes sont encore jeunes et faibles.
Il y a par ailleurs un autre défi à surmonter. Les nouveaux immigrants, des réfugiés fuyant les pays d’Afrique du Nord ou du Moyen‑Orient, n’adhèrent pas au socialisme européen. S’ils acceptent de devenir des agriculteurs, ils préfèrent les moshavim, les fermes privées.
Les kibboutzim ne servent plus de foyer d’accueil pour les réfugiés.
Le défi suivant sera la guerre des Six Jours de 1967, au cours de laquelle Israël – attaquant de manière préventive alors que ses voisins se préparent à l’envahir – remporte une victoire éclatante. Il conquiert la Cisjordanie à la Jordanie, le plateau du Golan à la Syrie, la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï à l’Égypte.
Les kibboutzim ne sont plus à la frontière. Par ailleurs, ils ne correspondent plus à l’éthique militaire israélienne : les Forces de défense israélienne misent sur la modernité et la technologie, grâce à cela, elles sont devenues la force militaire la plus puissante du Moyen‑Orient.

Les investissements extérieurs commencent à affluer. Israël devient un allié des États‑Unis. Les routes, les ponts, le réseau électrique, les ports et les aéroports sont tous améliorés. L’agriculture, principale activité des kibboutzim, n’est plus aussi importante au sein de l’économie.
Dubi Benari écrit qu’au fil de ces changements, les kibboutzim deviennent moins populaires. Menachem Begin, un ancien terroriste d’extrême droite dont l’élection en 1977 marque un changement radical dans la politique israélienne, les dénigre et les attaque.
Lors d’un discours prononcé en 1978 au kibboutz Manarah, Menachem Begin qualifie les kibboutzniks de « millionnaires vivant à côté de leurs piscines bien entretenues ».
En tant qu’homme politique Menachem Begin n’aurait jamais osé dire cela s’il n’avait pas remarqué un net changement dans l’opinion publique. Les kibboutzim ont perdu leur prestige. Leur aura romantique a disparu, observe Dubi Benari.
Le fait est qu’il y a un changement de génération. Les premiers colons étaient idéalistes. Avant la Seconde Guerre mondiale, les kibboutzim étaient peuplés presque exclusivement de jeunes. Ils ne pensaient pas vraiment à l’éducation des enfants ou aux soins pour les personnes âgées.

Cependant, ils correspondaient parfaitement au besoin d’Israël à cette époque. Ces communautés tiraient leurs valeurs de trois choses, écrit Dubi Benari : leur jeunesse, leur idéalisme et leur pauvreté.
La deuxième génération, née dans les kibboutzim, baigne dans l’idéologie socialiste mais se montre quelque peu sceptique. Malgré tout, au début des années 2000, la moitié de la deuxième génération de Kfar Blum y vit encore.
C’est à la troisième génération que l’érosion se produit pour de bon. La deuxième génération, écrit Benari, ne parvient pas à endoctriner les enfants. La troisième génération grandit avec de nombreux doutes.
Du fait des médias et d’Internet, cette génération grandit dans un monde où les frontières tendent à s’effacer. Une fois leur service militaire accompli, la plupart des jeunes décident de voyager et de visiter le monde pendant un an. Seuls 5 à 10% d’entre eux reviennent au kibboutz.
Le recul de l’importance économique des kibboutzim révèle leurs faiblesses structurelles.
Tout le monde est payé de manière égale, mais chacun s’investit différemment.
Les meneurs travaillent dur, prennent des responsabilités, font preuve d’initiative et se préoccupent de l’ensemble du kibboutz. Leur vie familiale en souffre souvent. Ils sont exposés à la critique et se sentent rapidement épuisés.
D’un autre côté, ceux qui contribuent le moins possible, qui ne travaillent pas trop dur.
Ils sont plus intéressés par ce que le kibboutz peut leur apporter – la nourriture, les biens et les opportunités de socialisation, écrit Dubi Benari.
La plupart se situent, bien sûr, au milieu.

Les pratiques de rotation du travail – qui consistent à retirer les personnes de leur poste pour donner une chance à tout le monde – entraîne souvent le remplacement d’un responsable habile par un parfait incompétent.
Les meneurs découvrent qu’ils peuvent gagner plus d’argent hors du kibboutz sans avoir autant de soucis. Beaucoup s’en vont.
Le fait de recevoir de la nourriture, des vêtements et d’autres produits de première nécessité « gratuitement », c’est‑à‑dire payés par le kibboutz, entraîne d’énormes gaspillages.
Les kibboutzim comme Kfar Blum seront finalement privatisés. Il faudra procéder par étapes, délicatement. Les premiers kibboutzniks ont souvent connu la faim au cours de leur enfance pauvre, ou pendant l’Holocauste. Le fait de devoir payer pour la nourriture – et de faire face à la perspective de ne pas en avoir assez – se révèle terrifiant pour certains.
Dubi Benari note que le marxisme lui‑même s’est éloigné de l’idéal d’ « égalité absolue » dès qu’il a formulé l’axiome « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ».
Dans les kibboutzim, on demande aux meneurs de donner plus, et ils le font, mais ils sont payés de la même manière que les tire‑au‑flanc.
Les kibboutzim doivent donc évoluer. Selon Laurie Rimon, le fait que tout le monde soit payé de la même façon était de plus en plus handicapant au fil des ans.
« Certains travaillaient plus, d’autres étaient des fainéants », se souvient‑elle. « Certains, peut‑être 20%, flânaient toute la journée sans travailler du tout. Mais ils recevaient quand même la même part que tout le monde. »

L’ancienne génération qui avait construit le kibboutz était plus motivée que la jeune génération, née sur place sans avoir eu le choix.
« Peut‑être qu’ils y croyaient [uniquement parce que] c’était une vie facile pour eux », explique Laurie Rimon.
Le miracle s’est produit, écrit Dubi Benari, une fois que les kibboutzim se sont mis à payer davantage leurs membres et selon d’autres principes. D’un seul coup, le gaspillage a pris fin.
Les bilans des kibboutzim se sont améliorés. Les membres qui travaillaient à l’extérieur étaient souvent moins payés mais ils s’en moquaient, car ils vivaient dans un endroit qui fournissait tous leurs besoins essentiels. Désormais, ils pouvaient demander et obtenir des augmentations de salaire à leurs employeurs extérieurs.
« Le principal changement », explique Avner Rimon, « a été de donner plus de responsabilités aux membres du kibboutz, d’arrêter de penser que le kibboutz était responsable de tout ».
Les premiers kibboutzniks étaient idéalistes. Nés dans l’adversité, la pauvreté ou la persécution, ils avaient eu des parcours dangereux, survécu à la guerre. « Les choses avaient été si difficiles qu’il était facile de motiver les gens. On surmontait les problèmes ensemble », poursuit Avner Rimon.
« Mais quand les choses sont devenues plus faciles, on a vu toutes sortes d’excuses apparaître, du type ‘je suis malade’, ou ‘je n’ai pas envie de le faire’. Ce n’était pas la majorité [mais c’est apparu]. »

« Les différends étaient là dès le premier jour. Il y en a toujours eu qui ne voulaient pas faire leur part du travail. »
« S’ils n’ont pas à le faire, et qu’ils obtiennent la même chose, alors pourquoi se fatiguer ? »
En se diversifiant, les kibboutzim n’ont eu d’autre choix que de mettre en place une équipe de direction, un conseil d’administration. Pour cela, ils ont souvent fait appel à des personnes extérieures.
Les membres du kibboutz pouvaient toujours remanier le conseil d’administration s’il le jugeait nécessaire, mais ils n’avaient plus voix au débat quant à la façon de gérer les entreprises. Et leurs entreprises, sans surprise, sont devenues plus efficaces et plus rentables.
Privatiser les actifs du kibboutz a été une étape difficile. Cela impliquait des questions épineuses sur la manière de partager ce qu’avaient construit les fondateurs, vivants ou morts.

Yonatan Porat, l’archiviste de Kfar Blum, est très sensible à ce sujet : il a voté pour la privatisation des actifs de Kfar Blum, mais il a ensuite considéré qu’il avait en un sens été privé d’héritage. Ses parents sont morts avant la mise en place du programme et leur contribution n’a pas été prise en compte dans le partage des biens.
D’autres éléments ont mené les Rimon à changer d’opinion quant à la propriété privée. Les appartements qu’ils construisaient en collectif étaient de qualité médiocre. Les murs peu épais laissaient passer le bruit des voisins, les odeurs de cuisine, etc. Il y a environ 15 ans, les Rimon ont construit leur propre maison.
Ils vivent aujourd’hui dans un logement confortable avec trois chambres à coucher et deux salles de bain. Pour les fondateurs des kibboutzim, être le propriétaire d’une maison, c’était être un bourgeois.
Aujourd’hui, la possibilité de construire une maison dans ce petit pays surpeuplé où la terre est chère est un argument de vente des kibboutzim. Cela permet d’attirer de nouveaux membres ou de faire revenir les anciens.
Lior Peretz vit à Rishon Letzion, au sud de Tel Aviv, avec sa femme Yaar et leur petit garçon Yuval. Il envisage de déménager au kibboutz Ein Carmel, au sud de Haïfa, près de la côte, où Yaar a grandi.
L’opportunité de posséder une maison fait partie de ce qui le motive. Ils ont déjà commencé à acheter des terrains par l’intermédiaire du kibboutz et à organiser les branchements d’eau et d’électricité.

Posséder un petit appartement dans une zone métropolitaine peut coûter 3 millions de shekels (environ 800.000 euros). « Pour ce prix, vous pouvez avoir un appartement d’environ 100 mètres carrés », explique Lior Peretz. Les jeunes Israéliens ont généralement besoin de l’aide de leurs parents pour s’offrir ce minimum.
« Nous pourrions essayer de trouver des maisons ailleurs » dans des zones moins chères, poursuit‑il, « mais le fait d’être dans une communauté et d’avoir une vie communautaire, dans un endroit qui n’est pas orthodoxe, ajoute à l’attrait ».
Selon lui, les juifs orthodoxes d’Israël, qui se regroupent, parviennent à créer un sentiment de communauté.
« Ici », explique Avner Rimon, en parlant de Kfar Blum, « vous pouvez construire une maison d’un étage au prix d’un appartement en ville ».
Au fil des ans, Kfar Blum s’est tourné vers des domaines autres que l’agriculture. Les travaux agricoles sont désormais effectués par des travailleurs thaïlandais qui vont et viennent dans le kibboutz.
Le kibboutz a fondé un hôtel, des écoles et une usine qui fabrique des systèmes de contrôle pour les arroseurs.

Kfar Blum a dû faire face à plusieurs chocs culturels au fil des ans, se souvient Yonatan Porat. Il est né dans le kibboutz qui a précédé Kfar Blum. Il a ensuite grandi et vécu toute sa vie à Kfar Blum.
Un des chocs a été le départ de nombreux immigrants, venus notamment d’Afrique du Sud ou des États‑Unis. Ils trouvaient les kibboutzim trop collectifs. Ils avaient besoin de plus d’intimité et n’appréciaient pas de ne pas pouvoir éduquer leurs enfants. Yonatan Porat a perdu de nombreux amis pour cette raison.
Un autre choc fut la fin du foyer pour enfants. Certains kibboutzniks qui avaient grandi, s’étaient mariés et avaient eu leurs propres enfants ne voulaient pas les confier au foyer.
En 1969, le kibboutz vote pour mettre fin à ce système, mais à l’issue du vote, le foyer est maintenu. Un an plus tard, cependant, un nouveau vote marque sa fin. Aujourd’hui âgé de 78 ans, Yonatan Porat se souvient. Il venait tout juste de se marier à l’époque et n’avait pas encore d’enfants.
Il a aidé à faire pression sur les membres réticents de l’ancienne génération pour permettre le changement. Dans le nouveau système, les enfants étaient élevés par leurs parents et ils pouvaient choisir de déménager dans les dortoirs des jeunes à 16 ans.
Au début, le kibboutz n’a pas facilité la tâche des parents qui souhaitaient ramener leurs enfants chez eux, raconte Yonatan Porat.
« Ils ont dit : ‘C’est votre décision. Vous pouvez déménager. Mais nous n’agrandirons pas vos maisons. Mais les parents ont récupéré leurs enfants même sans aménagements.’ »

« Mon frère vivait avec trois enfants dans 40 mètres carrés. C’était très petit. C’était le prix à payer, mais ils l’ont fait. »
Avec le temps, le kibboutz a donné des logements plus grands à ceux qui avaient des familles nombreuses.
Pour sa part, Yonatan Porat avait grandi dans le foyer des enfants et l’appréciait.
« Je ne pensais pas à aller vivre avec mes parents. Il suffisait de les voir l’après‑midi pour l’heure du thé. Il n’y avait pas de télévision. Nous étions toujours dehors, à jouer à des jeux. Tous ensemble. On aimait beaucoup ça. »
Les foyers pour enfants étaient considérés comme une caractéristique essentielle depuis l’ouverture du premier kibboutz, Degania, sur la mer de Galilée en 1910.
« Les enfants grandissent ensemble et vivent si près les uns des autres qu’ils sont vraiment soudés et s’identifient comme la nouvelle génération du kibboutz. »
Mais cela ne plaisait pas à tout le monde. Sa femme Jeri, qui a déménagé de Brooklyn à l’âge de 4 ans, était très malheureuse dans le foyer. Elle s’est enfuie chez sa mère, et sa mère ne l’a pas fait revenir.
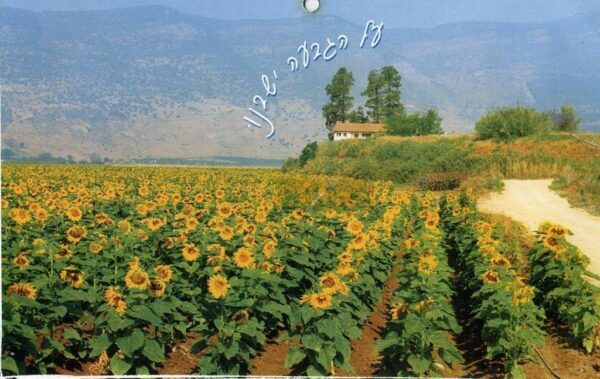
Le kibboutz possède toujours un foyer pour enfants, mais ils n’y vivent plus. Il organise des activités parascolaires et des gardes d’enfants.
Au fil du temps et des générations, le kibboutz a perdu des membres.
« C’était presque comme une maison de retraite il y a 15 ans », explique Laurie Rimon, car les jeunes partaient pour leur service militaire et ne revenaient pas. « Nous avons presque atteint un niveau critique. Mais certains ont commencé à revenir et d’autres les ont suivis. »
Le kibboutz a rebondi grâce à plusieurs initiatives. Il a créé une communauté alliée, un lotissement voisin. Les propriétaires paient une cotisation au kibboutz et utilisent certains services mais ne sont pas membres à part entière.
Seuls les enfants des membres peuvent rejoindre Kfar Blum en tant que membres à part entière, explique Avner Rimon, mais certains kibboutzim acceptent les étrangers.
Kfar Blum compte environ 300 membres à part entière qui vivent dans le kibboutz et près de 500 dans le lotissement. Dubi Benari écrit que beaucoup de membres de la troisième génération aiment vivre près du kibboutz sans avoir les responsabilités des membres à part entière. Ils apprécient de vivre près de leurs amis et de leur famille.

Avec le temps, Kfar Blum n’est plus une ferme collective mais davantage une communauté soutenue par l’argent des membres, expliquent les Rimon. C’est toujours quelque chose de plus qu’une ville américaine, déclare Laurie.
« Il y a un sens de la communauté que l’on n’a pas en vivant dans une ville. »
Laurie Rimon avoue qu’aucun de ses trois enfants, désormais tous des adultes, ni aucun de ses proches ne vit ici.
Un fils vit aux États‑Unis, une fille vit dans un autre kibboutz, et une autre fille vit à Tiv’on près de Haïfa. Elle espère que son fils et sa femme reviendront des États‑Unis.
« Ils reviendront quand ma petite‑fille ramènera à la maison un petit-ami que sa mère n’aime pas », dit‑elle en plaisantant.
Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?
Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.















