ENTRETIEN – Le grand reporter spécialiste de la criminalité, documentariste, auteur de nombreux ouvrages, en dernier lieu Braqueur, mercenaire, aventurier : de l’OAS au grand banditisme (Nouveau monde, 2025) Frédéric Ploquin répond aux questions d’Epoch Times sur le contenu de la loi contre le narcotrafic, la légalisation du cannabis et le profil psychologique de Mohamed Amra.
Epoch Times : La semaine dernière, les députés ont adopté la proposition de loi sénatoriale visant à « sortir la France du piège du narcotrafic ». Elle prévoit notamment la création d’un parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), ou encore la création d’un « dossier coffre ». Pensez-vous que ces mesures sont à la hauteur du fléau du narcotrafic ?
Frédéric Ploquin : Le piège s’est déjà refermé depuis longtemps. La séquence parlementaire que nous venons de vivre change cependant la donne : pour la première fois, on assiste à une prise de conscience par nos élus des risques que font peser sur notre société les ramifications du crime organisé. Les sénateurs ont montré l’exemple en adoptant ces nouvelles mesures à l’unanimité. L’affaire Amra, plus précisément l’exécution de deux surveillants de prison lors de son évasion au péage de Tancarville, a marqué les esprits.
Ce caïd avait grandi sous les radars en profitant des failles de la justice, et surtout de l’absence de coordination entre les différents parquets qui se penchaient sur son cas. Cet éparpillement a privé l’administration pénitentiaire d’un vrai diagnostic, qui aurait permis d’ajuster l’escorte du prisonnier lors de son transfert au palais de justice. Le dossier « coffre » vise à rééquilibrer la balance en faveur de l’accusation, en privant le suspect d’informations sur les conditions exactes dans lesquelles son activité criminelle a été détectée. Cela fera-t-il bouger les lignes ? L’idée est notamment de protéger les sources et certaines techniques d’enquête.
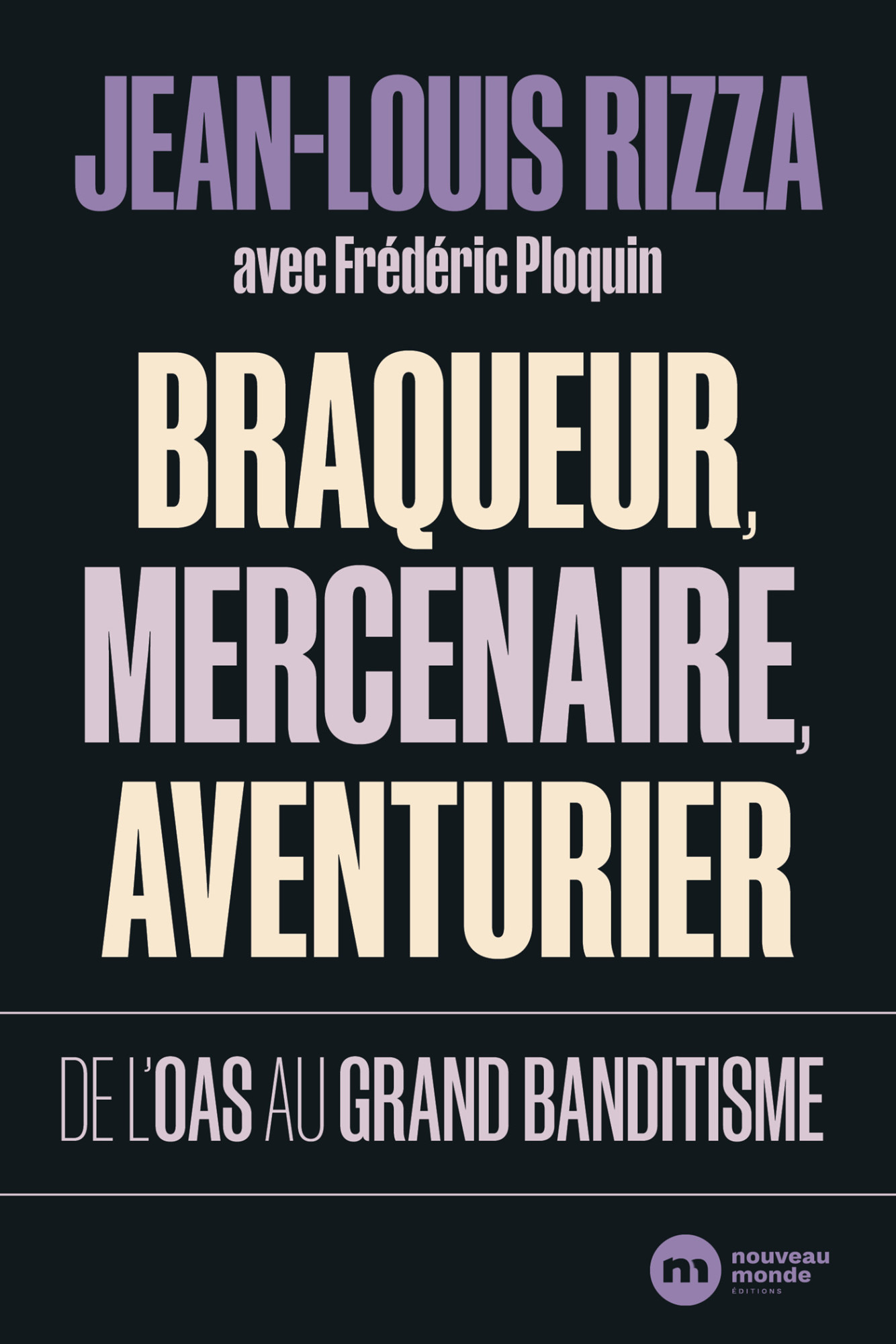
Le texte prévoit également le renforcement du régime des repentis. Pour vous, les repentis ont-ils un rôle à jouer dans la lutte contre les réseaux de trafic de drogue ?
Certains misent gros sur le statut de repenti. La vraie nouveauté est l’extension de ce dispositif aux crimes de sang, comme cela se pratique en Italie. Cela peut s’avérer efficace pour élucider des règlements de compte au sein d’équipes très structurées, mais le paysage criminel français n’est pas celui de l’Italie. La Camorra napolitaine ou la N’dranghetta, la mafia calabraise, sont des organisations pyramidales. Un seul repenti peut ébranler tout un système.
Le trafic de stupéfiants en France est le fait d’organisations éclatées, indépendantes les unes des autres, où l’on ne sait jamais très bien qui est le chef, comme le montre l’exemple de la DZ mafia, cette bande qui a assis son emprise sur plusieurs quartiers de Marseille. Les règlements de compte qui impliquent les membres de cette « mafia » sont presque tous élucidés par les services de police, notamment lorsqu’ils sont perpétrés par de très jeunes tueurs à gage amateurs recrutés sur les réseaux sociaux. Pour eux, ce statut peut offrir une porte de sortie, à condition qu’ils en aient l’envie, ce qui n’est pas gagné si l’on s’en tient aux profils connus.
Vous avez été amené lors de vos enquêtes à côtoyer des narcotrafiquants. Que vous ont-ils dit sur la répression ? Cela les dissuade-t-il ?
En côtoyant ces narcos à la française, du moins les plus jeunes, on comprend vite que le risque de la prison n’est pas pour eux une priorité. L’incarcération fait partie de leur décor, de leur cursus, et ils ont démontré que le fait d’être enfermé n’était pas un obstacle à la poursuite du business, du moins jusqu’à présent. Non, leur inquiétude est ailleurs et elle relève même souvent de l’obsession : plus que le risque d’être arrêté, ils craignent d’être pris pour cible par un concurrent plus ambitieux, plus déterminé qu’ils ne le sont. Ils craignent pour leur survie et s’ils se cachent, c’est d’abord pour échapper aux tueurs.
Pour le reste, ils savent pouvoir compter sur de bons avocats. Le nouveau régime carcéral annoncé par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a pour but de changer cette donne. L’idée est de concentrer les plus dangereux trafiquants dans des prisons où le régime de surveillance serait considérablement durci. De les mettre sous cloche, en quelque sorte, en les privant au maximum de liens avec l’extérieur.
Cela promet des heures difficiles aux surveillants de prison, mais l’expérience prouve que cela les dérange, en atteste les réactions des trois responsables présumés de la DZ mafia privés de téléphones aux Baumettes. La pression était telle qu’ils ont brandi l’arme fatale en proférant des menaces de mort contre un chef de détention. Ces prisons seront de terribles cocottes minute, où la menace rivalisera avec les tentatives de corruption.
Cette loi a relancé le débat sur la légalisation du cannabis, drogue la plus consommée en France. L’argument de l’ « assèchement des trafics » est souvent mis en avant par ceux qui soutiennent sa légalisation. Qu’en pensez-vous ?
Les Français consomment plus d’une tonne de cannabis par jour, selon les calculs les plus fiables. Confier ce marché à des acteurs assermentés par l’État pourrait permettre de faire rentrer de l’argent dans les caisses, par exemple pour financer la lutte contre le trafic des autres drogues, ou les campagnes de prévention. Cela lèverait la pression sur la police en tenue, qui pourrait consacrer le temps imparti à la chasse aux barrettes de shit à d’autres objectifs. Ce qui ne serait pas négligeable vue la pression qui pèse sur les effectifs.
Il est cependant patent que la seule perspective d’un débat sur le sujet crispe nos politiques. Face au sujet de la légalisation, le débat est balayé au profit des postures. Quiconque propose une modification des règles est aussitôt taxé de « laxiste », le mot qui tue en politique.
D’un point de vue criminologique, il serait illusoire de croire que la légalisation ferait disparaitre d’un coup de baguette magique le spectre de la criminalité organisée. En hausse constante, l’offre de cocaïne augmenterait mécaniquement avec la reconversion des dealers.
L’autre marché parallèle qui subsisterait est celui de l’approvisionnement des mineurs en cannabis, qui ne pourrait être le fait des magasins légaux. Il faudrait aussi s’attendre à une guerre commerciale, sur les prix et la qualité, dans laquelle l’État ne sortirait pas forcément gagnant.
Quels ont été les effets de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis sur les réseaux criminels chez certains de nos voisins, notamment l’Allemagne ou les Pays-Bas ?
Les Pays-Bas offrent un exemple intéressant dans la mesure où les fameux coffee-shops sont en place depuis longtemps. L’approche de ce pays a toujours été marchande, le commerce primant sur la question morale.
Les banques néerlandaises ont montré l’exemple en accueillant longtemps, les yeux fermés, les montagnes d’espèces générées par la drogue. La consommation n’a pas connu de pic, elle est restée à peu près stable, mais le vrai bilan est ailleurs.
Les chefs de file du commerce en gros de produits stupéfiants ont prospéré entre Amsterdam et Rotterdam, au point de former dans le pays un véritable kyste mafieux, avec un taux élevé de corruption et des menaces régulières sur les représentants de l’État comme sur les journalistes. En Allemagne, l’expérimentation en cours est trop récente, après des débuts chaotiques.
Le système qui se met en place pourrait permettre aux consommateurs issus des classes supérieures de ne plus se compromettre auprès des réseaux criminels, à condition bien sûr de se déclarer officiellement dans les échoppes dédiées. Ce qui se fait dans une ville comme New-York pourrait-il se tenter à Paris ou à Marseille ? Un programme permet à d’anciens dealers d’avoir pignon sur rue, avec une comptabilité en bonne et due forme. Une façon d’amoindrir les profits de l’économie souterraine, qui a cependant plus de ressources qu’on ne l’imagine.
Après plusieurs mois de cavale, Mohamed Amra a été interpellé le 22 février en Roumanie et a été remis aux autorités françaises. Il est aujourd’hui au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Début mars, dans l’émission « C l’hebdo », vous déclariez que pour lui, « son arrestation est une bonne nouvelle puisqu’il est au sommet de sa gloire ». Pourriez-vous revenir en détails sur son profil psychologique ?
Le large sourire arboré par Mohamed Amra lors de son interpellation en Roumanie peut se lire de différentes façons. Au-delà de la part de provocation évidente, de cette manière de lancer un bruyant « je vous em**rde », le fugitif semble célébrer une bonne nouvelle. C’en est certainement une pour le ministre de l’Intérieur, qui crie victoire, pour les dizaines de membres de la police judiciaire lancés à ses trousses et pour les familles des surveillants morts lors de son évasion. Pour lui, c’est moins évident, mais on peut se livrer au jeu des hypothèses. Cette arrestation permet à Mohamed Amra d’engranger publiquement les dividendes d’une cavale plus longue que la moyenne.
Il sourit pour afficher sa force et célébrer son nouveau rang, celui d’ennemi public N°1. À la « Star Academy » du crime, il est le gagnant du mois. Plus qu’à servir le champagne. Ce jour-là, il ne sait pas encore que ses conditions carcérales vont changer radicalement, et pas dans le bon sens, lui qui a gagné des galons de caïd depuis sa cellule. Il est dans une jouissance immédiate, celle du court terme.
La recherche de la gloire est-elle une caractéristique des grands bandits ?
Le bandit, par essence, est condamné à l’ombre, à la discrétion, à la dissimulation. Il doit garder pour lui la fierté du coup réussi, s’il ne veut pas se faire prendre. Il se prive d’une mémoire visuelle et ne peut pas raconter ses succès au premier venu. Il est condamné au silence. Moins il laisse de traces, plus il a de chances de passer entre les mailles du filet.
Prenez le cas de Jean-Louis Rizza, le gangster-mercenaire dont je viens de publier les mémoires. Il raconte comment il a monté un gang de serial-voleurs exclusivement composé d’anciens militaires et d’anciens pieds-noirs comme lui. L’équipe ne s’est jamais fait prendre.
À 72 ans, il décide de tout dire dans un livre, à la fois pour soulager sa conscience et sans dissimuler une forme de fierté. C’est assez récurrent chez les bandits de ce calibre. Il suffit de se souvenir comment Jacques Mesrine cherchait à capter la lumière et l’attention des médias.
Difficile d’oublier, également, le regard plein de forfanterie du roi de la belle, Antonio Ferrara, lors de son arrestation, comme s’il cherchait une forme de complicité et d’approbation auprès du public. Ou encore l’heure de gloire de Redoine Faïd, qui entre deux braquages s’est présenté aux caméras dans la peau du repenti, de celui qui avait tourné la page, avec la possibilité de raconter publiquement ses faits d’arme et d’afficher sa science de l’attaque de fourgons blindés.
Comment pouvez-vous nous aider à vous tenir informés ?
Epoch Times est un média libre et indépendant, ne recevant aucune aide publique et n’appartenant à aucun parti politique ou groupe financier. Depuis notre création, nous faisons face à des attaques déloyales pour faire taire nos informations portant notamment sur les questions de droits de l'homme en Chine. C'est pourquoi, nous comptons sur votre soutien pour défendre notre journalisme indépendant et pour continuer, grâce à vous, à faire connaître la vérité.















